
Les Journées de la persévérance scolaire (JPS) se déroulent du 11 au 15 février sur le thème « Nos gestes, un + pour la réussite scolaire ». Dans un cahier spécial sur l’éducation, Le Devoir introduit le sujet en ces termes :
Réduire le nombre d’enfants qui commencent leur scolarité avec un facteur de vulnérabilité, diminuer le décrochage scolaire, augmenter la proportion d’élèves qui obtiennent un diplôme avant 20 ans… Tous ces objectifs s’inscrivent dans la Politique de la réussite éducative du Québec. Les objectifs à atteindre sont grands et le réseau des CPE, garderies en milieu familial, privées ou subventionnées, la maternelle 4 ans, l’état des écoles, des services aux élèves ou encore les conditions de travail des enseignants sont au coeur de bien des débats. États des lieux et coup d’oeil sur différentes initiatives et divers projets qui peuvent être déterminants dans le cheminement des enfants, de la garderie à la cour d’école, en passant par le camp d’été. (Cahier spécial C, Éducation, Le Devoir,samedi et dimanche 10 février 2019, )
Je voudrais contribuer à la réflexion sur cet « état des lieux » en élargissant les termes du débat aux acteurs communautaires, qui ne sont pas mentionnés ici, et en abordant le rôle des bibliothèques publiques québécoises dans ce vaste chantier.
S’il fallait s’en tenir au principal document en cause, soit la Politique de la réussite éducative lancée le 21 juin 2017 sous le précédent gouvernement, cet exercice serait assez bref puisqu’une recherche par occurrence dans le texte ne donne aucun résultat associé au mot « bibliothèque ». Et ce même si la Politique porte un discours favorable à une approche communautaire de la littératie. Le mot « communauté » revient d’ailleurs 59 fois dans cette Politique qui compte 84 pages.
La Politique propose une vision visant à i. Agir tôt et tout au long de la vie et ii. Mobiliser la communauté éducative. À ce titre, cette vision prend en considération l’importance d’agir avant et au-delà du parcours scolaire dans un cadre de responsabilité qui n’est plus défini sur une base individuelle dans un contexte d’éducation formelle, mais qui est partagé par les acteurs de la communauté éducative.
À l’école des New Literacy Studies, les études soulignent en effet le caractère déficient des approches qui abordent l’alphabétisation et les littératies comme des enjeux essentiellement individuels et scolaires. Ces études mettent l’emphase sur une approche systémique où alphabétisation et littératies sont conçues en tant que pratiques sociales et culturelles reliant la famille, l’école (incluant afortiori les bibliothèques scolaires) et la communauté – dont les bibliothèques publiques et les autres acteurs communautaires font partie.
La Stratégie 0-8 ans qui a suivi la Politique a pris soin de désigner plus explicitement les acteurs communautaires afin qu’ils et elles se reconnaissent comme parties prenantes dans ce chantier et dans le partage des responsabilités qu’il implique :
Les huit premières années de la vie sont déterminantes dans toutes les sphères du développement global des enfants. C’est également au cours de cette période qu’ils réalisent les apprentissages les plus déterminants pour leur réussite éducative : la lecture, surtout, de même que l’écriture et la mathématique. S’ils ne possèdent pas les acquis attendus au terme du premier cycle du primaire, les enfants rencontreront plus de difficultés dans la poursuite de leur parcours scolaire. La capacité de lecture à cet âge, rappelons-le, est une compétence transversale liée à la réussite scolaire ultérieure : les enfants apprennent à lire pour pouvoir, par la suite, lire pour apprendre. Ces apprentissages se réalisent progressivement, d’abord par des activités d’éveil et de stimulation au sein de la famille, dans les bibliothèques publiques ou encore par l’intermédiaire des organismes communautaires qui offrent également ce type d’activités, et plus tard dans les services de garde éducatifs à l’enfance. (MCC, Stratégie 0-8 ans, p. 41)
Auparavant à l’automne 2016, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a interpelé les instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative (IRC) en leur confiant le déploiement d’une nouvelle mesure visant à valoriser et à promouvoir la lecture auprès des 0-20 ans et des parents. Cette mesure contient plusieurs propositions orientées sur la « création et consolidation d’une synergie entre les bibliothèques, le réseau scolaire et les différents partenaires ». Cette mesure visait le développement de projets et d’activités complétés à terme sous la forme d’un rapport devant être déposé le 31 décembre 2017. (Mesure sur la lecture, p.3)
Qu’en est-il de cette mesure, de ses résultats, et maintenant de cette orientation explicite en matière de littératie communautaire dans le contexte du changement de gouvernement? Pour le moment, les engagements du gouvernement actuel semblent prioriser des moyens pour « agir tôt » qui visent à combler les nombreuses lacunes des milieux de l’éducation formelle, c’est-à-dire, scolaires.
Des initiatives locales
Des initiatives mises en place dans la foulée de cette mesure notamment à l’enseigne du Réseau Réussite Montréal subsistent. Le cahier Éducation du Devoir présente quelques « gestes concrets » tel que le projet « Délire », qui vise « à accroître et maintenir l’intérêt pour la lecture chez les jeunes de 16 à 20 ans », le plaisir de lire surtout, que le contexte informel des bibliothèques, ici les Bibliothèques de Montréal, favorisent. Des projets se dessinent également à plus long terme, par l’entremise de l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ), grâce à un financement du MEES, qui suggèrent le début historique d’une reconnaissance de leur mission éducative, pourtant séculaire, et qui visent à développer des outils et des formations auprès du personnel des bibliothèques sur la littératie familiale.
D’autres exemples d’initiatives locales donnent un aperçu de la diversité des actions, mais surtout de leur caractère intentionnel en matière de soutien à la littéracie familiale et de persévérance scolaire. Certains de ces exemples m’ont été fournis par la Bibliothèque de Sainte-Julie (que je remercie) : heures du conte; club de lecture d’été; le coin des Apprentis Sage! : Un coin jeu favorisant la stimulation du langage dédié aux tout-petits et leurs parents avec des jeux de stimulation du langage pour les 0 à 5 ans; des jeux éducatifs sont mis à la disposition des parents et les intervenants en petite enfance qui veulent les emprunter; la Rimbambelle; l’escouade du livre en été dans les parcs de la ville avec deux animatrices entourées de livres passionnants proposent aux jeunes des lectures amusantes ainsi que des activités stimulantes pour les 5 à 14 ans; club de lecture de la livromanie pour les 8 à 11 ans (de Communication-Jeunesse).
Outre le projet « Délire », les bibliothèques de Montréal dispose aussi d’une offre locale à laquelle s’ajoutent des actions coordonnées par la Direction pour l’ensemble du réseau et dont on peut apprécier l’étendue et la profondeur dans ce document.
Les exemples d’activités et de collaborations en lien avec les littératies et la réussite éducative impliquant les bibliothèques apparaissent assez nombreuses et répandues. En revanche, personne, aucun ministère, aucun service des milieux documentaires ou autre association, n’est en mesure de produire un portrait fidèle de la situation, c’est-à-dire, de ce que font les bibliothèques publiques québécoises sur ce plan – en dehors d’opinions, d’anecdotes, de retours d’expérience. Ce qui revient à admettre que l’on ne peut pas, en ce moment, produire de véritable « état des lieux » qui nous permettent de décrire de façon rigoureuse leur contribution pour une meilleure planification de leur action et de leur impact à l’échelle locale et nationale.
Des conditions de réussite pour la réussite scolaire et +
Je souhaiterais attirer l’attention sur le fait que, au-delà des initiatives locales, les bibliothèques publiques constituent une opportunité pour agir de façon structurée puisqu’elles réunissent une ensemble de conditions susceptibles d’augmenter l’impact d’une stratégie pour la littératie et la réussite scolaire qui soit susceptible d’avoir une portée nationale :
- Ancrées dans les communautés, elles sont réparties sur l’ensemble du territoire : 96 % de la population québécoise est desservie par une bibliothèque publique (Institut de la Statistique, Statistiques générales des bibliothèques publiques, 2015);
- Davantage de personnes sont abonnées aux bibliothèques publiques qu’il y en a d’inscrites dans les écoles;
- Ce sont des équipements publics, financés par les contribuables, via le Ministère de la culture et des communications ainsi que par les municipalités; et donc des relais publics de proximité pour la réussite qui sont directement mobilisables;
- Elles sont organisées en réseaux et opèrent en un système de collaboration local, national et international;
- Les littératies sont au coeur de leur mission, tout comme l’apprentissage tout au long de la vie; et au sujet de la littératie communautaire, il faut savoir que les bibliothécaires sont formé.e.s aujourd’hui au développement communautaire stratégique autant qu’au développement de collections;
- De plus en plus, elles adoptent une perspective de care/justice sociale et se préoccupent des populations vulnérables ou socialement exclues et des obstacles systémiques qui freinent le développement des capacités associées aux littératies.
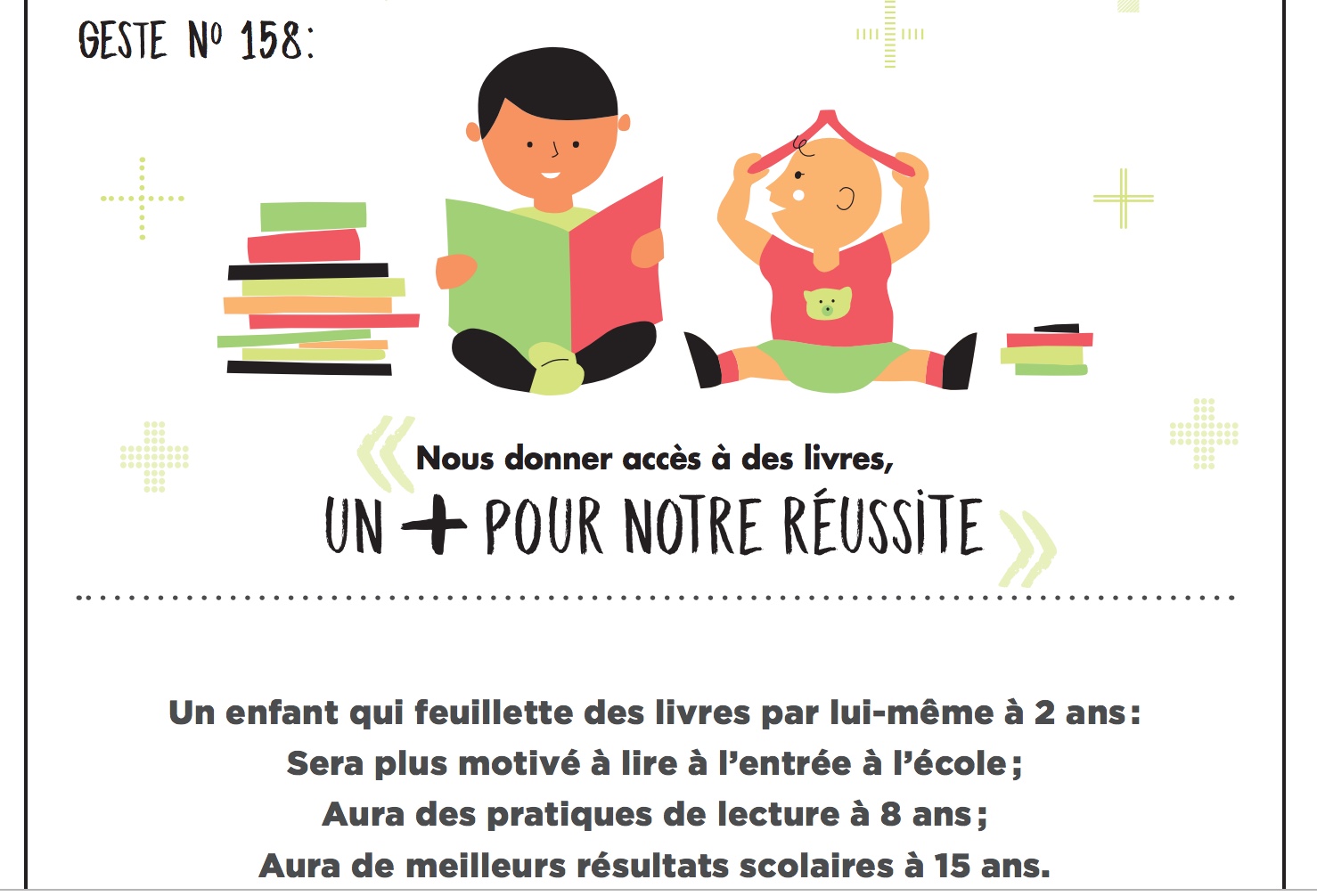
La perspective d’une stratégie nationale qui serait à même de saisir cette opportunité et de mieux utiliser ces services publics – en tant que financés par des fonds publics – est un défi. On pourrait parler du défi des trois « P » : le défi du pilote, le défi des politiques publiques et le défi du personnel.
Pas de pilote, de politique et personnel
Le défi du pilote s’entend plutôt comme le défi de ne pas avoir de pilote dans l’avion. Ballotées entre le MCC (qui met l’emphase sur la fonction culturelle, et surtout leur capacité à supporter l’industrie du livre, sans prendre en considération leur mandat éducatif et sans intervenir sur les vues souvent décalées des villes) et le MEES (duquel elles ne relèvent pas même si ce sont des institutions d’éducation assumées à travers tous les énoncés de mission internationaux qui les concernent), les bibliothèques publiques du Québec sont plutôt orphelines, adoptées par des maires qui ne savent pas trop quoi en faire, soucieux surtout qu’elles ne leurs coûtent pas cher.
Elles sont aussi « sans papier », c’est-à-dire qu’elles ne sont pas en mesure de se développer à l’aide de politiques publiques appropriées et suffisamment concrètes au plan national. Dans ces conditions, les bibliothèques publiques font figure de service public mal utilisé/géré par les gouvernements locaux et nationaux. Une planification globale, une stratégie nationale pourrait définir des orientations et des dispositifs incitant les villes à offrir des services de qualité en matière de littératie sur l’ensemble du territoire québécois afin d’avoir plus d’impact.
Faudrait-il que le « geste » soit une loi? La Suède s’est récemment dotée d’une loi pour ses bibliothèques dont une des priorités est la littératie.
Le défi du personnel est un des autres grands enjeux des bibliothèques publiques québécoises. À l’heure actuelle, il y a près de deux fois moins de bibliothécaires ETC (employés à temps complet) par 10 000 habitants dans les bibliothèques publiques du Québec que dans celles des différentes provinces canadiennes ou encore dans celles de quelques villes québécoises qui desservent des populations plus largement anglophones supportées par des administrations municipales qui, traditionnellement, en ont reconnu, la valeur.
Je reprends les propos des Denis Chouinard, Président de l’ABPQ, à l’automne dernier :
Ainsi, 65 % des municipalités comptent à leur bibliothèque moins de quatre employés à temps complet, indiquent les données 2017 de Statbib. « Comment peuvent-ils faire pour fonctionner ? », se demande M. Chouinard, qui a la chance, à la bibliothèque de Mont-Royal, de faire partie d’une équipe de 28. Car sa bibliothèque, depuis des décennies, est exceptionnellement choyée par le conseil municipal (voir encadré). « Si on veut que même les toutes petites biblios jouent leur rôle, il faut un minimum de personnel pour les animer, et pour gérer les collections. » Actuellement, 49 % des municipalités n’emploient aucun bibliothécaire. Près de 17 % des bibliothèques n’ont pas d’employés spécialisés — ni bibliothécaire, ni technicien en documentation. Le Québec compte 0,64 bibliothécaire diplômé par tranche de 10 000 habitants, selon les statistiques de 2015. Comparativement, l’Ontario en a 1,04, la Colombie-Britannique 1,07, et les États-Unis, en moyenne 1,01. (Catherine Lalonde, La bibliothèque publique, une richesse sous-exploitée, Le Devoir, 22 octobre 2018)
Sous la forme d’un tableau dans un des derniers rapports publiés par l’Observatoire de la culture et des communications du Québec en 2015, cela ressemble à ceci :
Ce qui suggère que l’on n’a pas encore compris et agi en phase avec la transformation des besoins des usagers et des bibliothèques du 21e siècle, avec la transition des collections vers les connexions; que l’on entretient encore la vision de la bibliothèques comme dépôt de livres au dépens d’un modèle de service orienté sur le développement communautaire, facilitant les littératies familiale, scolaire, communautaire – et ce même si on se targue de faire des « bibliothèques tiers lieux ». Un peu plus d’outils, un peu plus de formation ne nuira jamais, mais le problème de fond réside dans la précarité des équipes professionnelles au sein des bibliothèques publiques.
Cette situation de sous-dotation professionnelle explique aussi la quasi-absence de bibliothécaires jeunesse dans les bibliothèques publiques québécoises, un luxe qui, dans le meilleur des cas, est réservé à quelques grandes villes (Montréal?). Ces bibliothécaires jeunesse sont définitivement parmi les mieux placée.s pour développer et programmer des services en phase avec les connaissances les plus actuelles et les plus pointues sur les questions de littératie pour les publics jeunesse au sein des communautés. La rareté des bibliothécaires jeunesse est un autre aspect qui caractérise le cadre inéquitable du système québécois des bibliothèques publiques, que ce soit entre les villes du Québec ou from coast to coast; un autre chapitre de la gestion déficiente des bibliothèques publiques québécoises.
Sans doute « l’addition d’une multitude de gestes à la portée de tous, parents, membres de la famille, amis, éducatrices, enseignants, intervenants, élus ou encore décideurs, peuvent avoir une influence concrète sur la persévérance et la réussite des jeunes. » comme on le promeut dans le cadre des JPS. Je souhaitais faire valoir, c’est ma conclusion, qu’une gestion et une planification nationale conséquentes des bibliothèques publiques est un des scénarios parmi les plus prometteurs en vue d’avoir un impact structurant sur la persévérance et la réussite des jeunes. Mais est-ce que l’on y tient vraiment? C’est dit. Bonnes JPS !
+++
Des exemples d’initiatives en lien avec la littératie et la persévérance scolaire en bibliothèque publique :

Laisser un commentaire